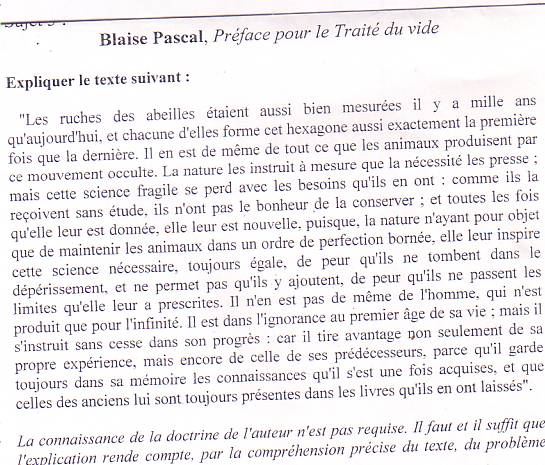|
Peut-on apprendre à penser ?
Penser, comme activité générale envisagée en elle-même et indépendamment de tout
contenu ou de tout objet, semble être naturel chez l'homme en un double sens :
c'est l'activité en laquelle se manifeste son essence, et c'est une activité
qui, de ce fait, s'exerce d'emblée et sans avoir à être apprise. Pouvoir
l'apprendre impliquerait que l'on puisse recevoir ce qui touche à l'essence
même, si bien que l'on aurait été d'abord dépourvu de celle-ci : ce qui paraît
absurde. Mais ce constat d'absurdité suppose qu'apprendre consiste seulement à
recevoir ce que l'on n'avait pas ; cela suppose en outre que nous posséderions
notre essence comme quelque chose de tout fait, ou comme quelque chose dont le
développement se ferait de façon automatique et nécessaire : la pensée serait
alors semblable à une sorte d'instinct, ce qui paraît non moins absurde. Il
s'agit donc de tenter de comprendre en quel rapport bien particulier l'homme,
sujet de la pensée, est avec sa propre essence. Celle-ci est-elle pour lui,
comme pour les autres êtres, une possession immédiate, ou est-elle ce qu'il a
sans cesse à prendre, à reprendre et à apprendre ?
Lorsqu'elle a la forme du « penser à » ou du « penser que », la pensée semble
douée d'une spontanéité qui précède tout apprentissage : qu'il s'agisse de
tourner son attention vers un objet ou d'en produire une image, dans le premier
cas, ou de former des jugements, dans le second, tout le monde pense, sans avoir
jamais reçu d'enseignement qui aurait porté directement sur ces activités
elles-mêmes.
Certes, pour tout le monde ces dernières se sont développées peu à
peu au cours de la petite enfance, sous la sollicitation des choses et des
personnes formant l'entourage dans lequel on vient au monde ; le tout jeune
enfant dirige peu à peu son attention sur un nombre croissant d'objets, et de
manière de plus en plus soutenue ; mais peut-on appeler « apprendre » le simple
fait de recevoir des stimulations, au gré des circonstances, et d'y répondre de
manière immédiate ? N'y a-t-il pas plutôt là un processus qui se déroule
de lui-même,
et sans faire
lui-même
l'objet d'une attention ?
Pourtant, dans le cas de la pensée comme formation de jugements,
c'est-à-dire de liaisons établies entre des idées (selon la définition
classique : entre un « sujet » et un « prédicat »), le langage est
nécessairement impliqué, et il semble incontestable que le langage doit être
appris : on ne peut inventer à partir de soi ni les mots, ni la manière de les
agencer. Mais, premièrement, là encore l' apprentissage affecte la forme d'un
processus par imprégnation, se faisant tout « naturellement » et pour ainsi dire
involontairement ; à l'enfant qui naît entouré de personnes qui parlent, il est
aussi impossible de ne pas « apprendre » à parler, qu'il est impossible au jeune
animal de ne pas développer son instinct : ni l'un ni l'autre n'ont à y penser
avec attention, à se mettre en position d'élève ou d'apprenti, pour y parvenir ;
voilà qui donne au terme
apprendre,
si l'on peut encore le conserver, un sens bien particulier et bien restreint.
Deuxièmement, il y a lieu de se demander si apprendre à parler et apprendre à
penser sont une même chose ; forme objective et « corps » de la pensée, comme le
dit Hegel, le langage ne coïncide cependant pas avec cette dernière purement et
simplement : ce qui le montre, c'est que le langage peut être lui-même
l'objet
de la pensée, ce qui implique que celle-ci peut s'en distinguer alors même
qu'elle ne cesse de s'exprimer en lui.
Enfin et surtout, quant à son
contenu,
la pensée sous la forme du simple jugement ne paraît pas pouvoir être apprise,
dans la mesure où elle est manifestation de ce qu'est celui qui pense, envisagé
dans ses qualités ou ses particularités. Si, en effet, nos idées et nos
jugements sont des effets ou des reflets de ce que nous sommes, avec nos
besoins, nos intérêts, nos habitudes, alors leur production a de nouveau le sens
d'un processus spontané. En tant qu'opinions, nos pensées « sont là », et même
« toujours déjà là », de manière nécessaire : c'est bien ce que constate
Descartes dans son
Discours de la méthode
[ou Platon dans l'allégorie de la caverne avec la figure du prisonnier]
lorsqu'il trouve en lui quantité de croyances, de convictions présentes
malgré lui,
et inévitablement,
avant
tout regard lucide sur soi-même. Sans doute certaines de nos opinions paraissent
plutôt résulter de nos relations avec l'extérieur ; nos parents et précepteurs,
voire les « maîtres à penser » dont notre société véhicule les idées,
volontairement ou non, nous ont « mis en tête » bien des jugements ; avons-nous
pour autant appris ces derniers ? Recevoir passivement et sans même s'en rendre
compte de tels contenus en son esprit, est-ce apprendre ? Ici se révèle
l'insuffisance de la simple opposition entre « inné » et « acquis », dans la
mesure où tout ce qui est acquis ne peut être considéré pour autant comme
appris. La simple répétition, l'imitation inconsciente et
privée de pensée
sont bien des « acquisitions », mais sont-ce des apprentissages ? Si oui, cela
ne pourrait être qu'au sens le plus immédiat et le moins authentique de cette
notion.
Apprendre à penser ne semble donc pas possible, sauf à reconnaître toute simple
réception involontaire comme un apprentissage. Mais cette conclusion dépend d'un
double présupposé, sur lequel il faut maintenant revenir : que penser consiste à
« avoir des idées » ou à « penser que », autrement dit à avoir des opinions ; et
que le sujet de cette activité soit un agrégat de qualités. Ce sujet, qui se
présente comme un « on » plutôt que comme un « je », en est-il vraiment un ? Et
cette pensée qui imite, répète ou reflète en est-elle vraiment une ?
La pensée comme production ou réception d'opinions semble pouvoir être comprise,
selon une formule apparemment paradoxale, comme une pensée qui ne pense pas ; et
son inaptitude à l'apprentissage tiendrait alors, précisément, à cette absence
de pensée en elle : ce qui semblerait indiquer
a contrario
qu'une pensée qui pense vraiment peut, voire doit être apprise. C'est ce que
suggère du moins la conception platonicienne de la pensée. En effet, l'opinion
apparaît chez cet auteur comme étant dans un triple déficit de pensée.
Tout d'abord,l'homme de l'opinion (figuré par nombre des
interlocuteurs de Socrate, comme Calliclès dans le
Gorgias,
mais plus directement par les prisonniers dans la fameuse allégorie du livre VII
de la
République)
ne sait pas pourquoi il pense ce qu'il pense ; même lorsqu'il raisonne, c'est à
partir de jugements tenus par lui pour des évidences absolues, dont les
fondements lui échappent : ainsi les prisonniers de l'allégorie ont-ils
dans leur dos,
hors de leur champ de vision, la cause de ce qu'ils voient. Cet homme entretient
alors avec ses pensées un rapport d'adhérence immédiate, sans recul et, à tous
les sens du terme, sans raison.
Ensuite cette absence de raison se retrouve entre ses idées
elles-mêmes : simplement juxtaposées, s'enchaînant selon une simple succession
chronologique, elles sont sans véritables liens entre elles. Chaque idée
constituant un élément isolé, dont la source est ignorée, elle est séparée des
autres idées par un vide, un simple « et puis », de sorte que l'on ignore
pourquoi et comment telle idée vient à la suite de telle autre, pourquoi dans
cet ordre plutôt que dans un autre. Bref :
les
pensées ne sont pas les fruits de
la
pensée, elles ne forment pas un tout se déployant à partir d'un principe commun.
Enfin l'homme de l'opinion est dans un rapport d'adhérence
immédiate
avec lui-même.
Il se voit et se traite comme une somme de qualités, sans distance intérieure,
exerçant sa pensée comme il exerce n'importe quelle fonction naturelle : selon
l'évidente spontanéité du « je pense ce que je pense parce que je suis ce que je
suis ».
Ainsi, aussi bien quant au rapport du sujet avec ce qu'il pense,
que quant au rapport des pensées entre elles, et quant au rapport du sujet avec
lui-même, la pensée est absente et l'immédiateté règne. Pour être pleinement
elle-même, la pensée devra donc s'interroger sur ces rapports et les modifier.
Non pas remplacer ses anciennes opinions par de nouvelles, ou celles des autres
par les siennes : de tels changements ne modifieraient que nos idées mais non
pas la
manière dont nous les avons,
alors que l'essentiel est justement là. L'élévation libératrice du prisonnier
platonicien ne consistera pas d'abord à voir de nouvelles choses, mais à les
voir
autrement :
c'est dans la manière même de regarder que la pensée véritablement réside. En
quoi cette modification substantielle consistera-t-elle, et en quoi
constituera-t-elle un apprentissage ?
L'élève qui, ayant auparavant appris par cœur le théorème de Pythagore, en
arrive ensuite à comprendre la démonstration dont celui-ci résulte, a toujours
dans l'esprit le « même » contenu (le théorème considéré en lui-même n'a pas
changé), mais son
rapport
à ce contenu est désormais d'une autre nature : il sait pourquoi ce théorème dit
ce qu'il dit, et pourquoi ce qu'il dit est vrai. Au lieu d'être un immédiat, le
théorème est maintenant relié à autre chose, médiatisé, et les éléments qui le
composent ne sont plus seulement juxtaposés, mais réunis eux-mêmes par des liens
logiques nécessaires. Enfin une distance intérieure existe maintenant en l'élève
lui-même, entre le sujet pensant et l'individu qu'il est : il n'a pu accéder à
ce contenu de pensée universel, totalement indépendant de ses propres qualités
contingentes, qu'en pensant hors de celles-ci, sans elles, voire contre elles.
En somme, la pensée est devenue une vraie pensée, et le sujet est devenu un vrai
sujet, dans un seul et même mouvement.
Or rien dans ce mouvement ne se fait tout seul, naturellement, pas
même selon un simple processus d'« expérience » se déroulant pour ainsi dire
malgré le sujet, au fil aléatoire des rencontres et des circonstances. Ce qui
permet cette double accession de la pensée et du sujet à leur essence véritable,
ce n'est pas l'expérience mais l'exercice,
qui requiert, lui, l'application de la volonté à une tâche qui ne se présente
pas au hasard, mais qui est élaborée par la pensée elle-même – et, si
l'expérience peut correspondre à cette exigence, c'est à condition d'être
expérience
scientifique,
et non simple vécu subjectif. L'idée d'apprentissage semble alors s'imposer tout
en prenant enfin son véritable sens ; bien loin d'être une réceptivité passive,
elle apparaît comme une activité sur soi-même, qui consiste moins à « recevoir »
qu'à
engendrer
les pensées à partir de soi, et de soi en tant que sujet dépouillé de toute
particularité. Apprendre ne peut alors signifier que comprendre, et comprendre
semble signifier : laisser la penser produire ses propres contenus. L'élève
mathématicien évoqué ci-dessus, lorsqu'il a compris (et donc vraiment appris) le
théorème, possède désormais celui-ci comme quelque chose qui ne vient pas de
l'extérieur, mais de l'intérieur de son esprit : il serait à peine exagéré de
dire qu'il en est devenu
l'auteur.
Mais si apprendre signifie comprendre de la manière qui vient d'être dite, un
paradoxe paraît en découler aussitôt. Car comprendre est œuvre de la pensée, qui
est pourtant censée être le résultat de l'apprentissage : pour pouvoir être
apprise, la pensée devrait à la fois ne pas être encore là et être déjà là.
Comment comprendre un tel mélange de présence et d'absence ? Et en quoi est-il
propre à la pensée, faisant de celle-ci une activité incomparable à toute autre,
et de son apprentissage un apprentissage à nul autre pareil ?
Si apprendre, en son sens strict, consiste bien à devenir soi-même le sujet,
c'est-à-dire l'auteur de ce qui est appris, cela ne paraît possible que
lorsqu'il s'agit de contenus qui relèvent de fond en comble de la pensée, et
sont un pur produit de celle-ci. Autant cela semble être le cas des
mathématiques, par exemple, autant ce ne peut être le cas lorsque la pensée
« s'applique » à autre chose qu'elle-même, comme c'est par exemple le cas en
histoire. Cela semble indiquer que la pensée n'est pleinement elle-même que
lorsqu'elle prend pour objet un certain contenu, alors qu'elle ne peut qu'être
partiellement elle-même lorsqu'elle en envisage d'autres.
Dans un théorème de mathématiques, en effet, il n'y a rien que la
pensée n'ait elle-même produit en suivant sa propre nécessité interne : celle-ci
n'a affaire qu'à elle-même, et tout ce qu'elle apprend, elle ne l'apprend que
d'elle-même. C'est pourquoi tout le monde peut, en droit, en produire à nouveau
le contenu à partir de soi. Mais en histoire, il n'en va pas ainsi ; l'objet
étudié n'est pas lui-même produit par la pensée, mais se présente comme un
donné
extérieur,
comme un ensemble de faits, d'événements, d'actes qui
sont ainsi,
et qui aurait pu être autrement. Aussi, apprendre en mathématiques signifie-t-il
purement et simplement comprendre, alors qu'en histoire, apprendre signifie au
moins en partie : constater que c'est ainsi. Et si, à l'instar du petit esclave
du
Ménon
chez Platon, tout le monde peut redécouvrir une propriété géométrique en
explorant son propre esprit et lui seul, en revanche nul ne peut découvrir par
ce même moyen que Napoléon est mort en 1821 plutôt qu'à une autre date. Deux
conséquences majeures en découlent enfin.
Premièrement, l'on comprend pourquoi Platon, en sa fameuse théorie
de la réminiscence, soutient que « apprendre n'est rien d'autre que se
ressouvenir » : c'est retrouver en soi-même
les
pensées nécessairement incluses dans
la
pensée dont on est le sujet. Mais l'on comprend du même coup que cela n'est vrai
que d'une forme de pensée bien précise : celle dans laquelle la pensée est
elle-même l'origine de tout son contenu, de sorte qu'il n'y a rien, en elle, qui
demeure impensé. Par rapport aux autres formes de pensée (qui, comme l'histoire
par exemple, comportent une part irréductible de non pensée), celle-ci n'est
donc pas à concevoir comme seulement « plus développée » ou « plus
approfondie », mais bien comme étant plus conforme à son
essence ;
elle seule, en un mot, est une vraie pensée.
Deuxièmement, si apprendre est se ressouvenir, c'est que
l'ignorance est oubli : ainsi Platon exprime-t-il le mélange étonnant de
présence et d'absence qui caractérise la pensée, son aptitude à être déjà là
alors même qu'elle n'est pas encore là. On pourrait certes en dire autant de
tout ce qui existe « en puissance », comme le dit Aristote, par exemple de
l'être vivant qui, sous forme de graine ou d'embryon, est déjà sans pourtant
être encore ; mais tandis que l'organisme vivant se développera et deviendra
lui-même de façon naturelle,
involontaire
et
nécessaire,
sans apprentissage d'aucune sorte, la pensée ne se réalisera que si elle le veut
et s'y emploie : à elle et à elle seule, il est donné de décider elle-même dans
quelle mesure elle sera ou non conforme à elle-même. Et si – ultime image
platonicienne – apprendre peut aussi être décrit comme une œuvre d'accouchement,
c'est à condition de préciser que, lorsque cette œuvre est effectuée dans toute
sa profondeur, les parents, l'accoucheur et l'enfant ne font qu'un.
Finalement donc, l'étrangeté et le paradoxe demeurent, et l'on n'a pu que les
découvrir et les voir plus clairement, non les dissiper. Penser semble être ce
qui peut et doit être appris, puisque rien, dans cette activité, ne se fait
naturellement ou instinctivement, et cela d'autant plus que la pensée est
véritablement pensante ; et penser semble être ce qui ne peut absolument pas
être appris, puisque la pensée est elle-même la condition et l'agent de
l'apprentissage, et ce d'autant plus que l'apprentissage en est vraiment un.
Énigme qui se prolonge en cette autre, concernant plus directement notre statut
de sujet : nous sommes origine de la pensée lorsque nous pensons vraiment, et en
ce sens nous n'avons pas d'autre maître que nous-même ; mais le pourrions-nous,
si la pensée ne prenait pour nous le visage d'autrui, d'un Socrate à la fois
désireux et capable de favoriser, du dehors, ce mouvement qui ne peut être
qu'intérieur ? |